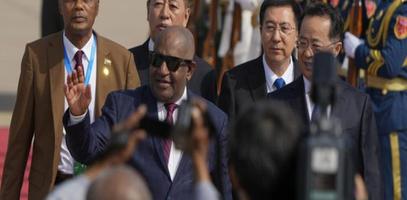Jacob Zuma, face aux motions de censure en Afrique du Sud ; les Congolais Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila face à leur peuple ; au Togo, Faure Gnassingbé face à la rue. Tous se sont refusé à répondre favorablement aux appels pressants et multiples à la démission. Pourtant, bien avant eux, des présidents africains avaient «abdiqué» de la fonction suprême au cours même de leur mandat. «La Tribune Afrique» vous en dresse une liste non exhaustive.
Il faut remonter loin dans les archives de la politique en Afrique pour trouver un président africain qui quitte par la démission le confort douillet, les salons feutrés et les dorures du palais. Plus récemment, ni le Togolais Faure Gnassingbé et le Congolais Joseph Kabila, aux prises avec la colère de la rue, leur homologue de Brazzaville Denis Sassou Nguesso qui se maintient au prix de protestations violemment réprimées, ni l'Algérien Abdelaziz Bouteflika que l'on dit alité, ou le Tunisien Béji Caïd Essebsi qu'on dit trop âgé, encore moins le Sud-africain Jacob Zuma qui accumule les scandales, n'ont succombé aux sirènes de l'appel à l'abdication.
Pourtant, contraints par la force, la ruse ou, plus rarement de leur propre chef, certains de leurs ex-pairs africains ont enclenché la clause de l'abdicataire et quitté la barque par la grande porte ou la fenêtre exiguë de l'Histoire.
Léopold Sedar Senghor, la démission comme cadeau de fin d'année
31 décembre 1980 au Palais du Plateau à Dakar. La traditionnelle allocution de présentation des vœux du président de la République a un arrière-goût amer pour les Sénégalais. Lorsque le chef de l'Etat sénégalais apparaît dans les écrans, il fait une annonce qui, en dépit des prémices quelques mois plutôt, surprend tout le peuple.
A 74 ans, Léopold Sédar Senghor, locataire du Palais depuis l'indépendance du pays en 1960, quatre fois réélu, renonce à sa charge de président de la République du Sénégal qu'il occupe depuis 20 ans. Dans la journée en réalité, le poète-président avait saisi le président du Conseil constitutionnel, le juge Kéba Mbaye, afin qu'il recueille sa démission et dans le même temps, le serment de Abdou Diouf, son Premier ministre issu du même parti qui lui succède au poste.
Pour justifier sa démission, Léopold Sédar Senghor qui a refusé une proposition de loi pour lui assurer la « présidence à vie », évoque son âge avancé qui ne lui permet pas de travailler plus de «10 heures par jour en moyenne» mais aussi sa volonté d'amorcer une alternance démocratique par le multipartisme ou un renouvellement générationnel au sein de son propre parti, le Parti socialiste (PS).
Et pourtant loin de l'angélisme, il est possible qu'en politicien madré, le Président Senghor a pu mesurer suffisamment les conséquences politiques d'une situation sociale exacerbée par une crise économique qui conduira après lui, à la mise en place de programmes de redressement des structures économiques et -peut-être- politiques.
Seize ans après sa mort intervenue le 20 décembre 2001, on se souvient plus de Léopold Sédar Senghor comme d'un poète, rappelant qu'il est le premier Africain à faire son entrée à l'Académie française. Mais il faut aussi ajouter qu'il fut le premier président africain à démissionner sans pression. Il meurt à Verson en France, à l'âge de 95 ans.
Ahmadou Ahidjo, le « malade imaginaire » bascule le destin en une heure !
Ce 4 novembre 1982, sur les antennes de Radio Cameroun, le traditionnel journal de 20 heures, commence par un retard meublé avec la répétition aussi agaçante qu'angoissante du générique. Mais lorsque cesse la « torture » musicale à 20h20, le journal parlé s'ouvre sur un coup de massue politique au plus haut sommet de l'Etat.
«Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de Président de la République du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à 10 h ». Sans ambages, la voix forte qui retentit sur les ondes ce jeudi-là, c'est celle d'Ahmadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, qui annonce au peuple une décision qu'il a murie depuis des mois dans un scénario digne d'un polar politique.
La trame en a pourtant été écrite quelques mois voire années plutôt. Depuis le congrès de l'Union nationale du Cameroun (UNC) en 1975, le Président Ahidjo fait prospérer l'idée d'une sortie de la scène politique mais personne n'y croit encore moins ne s'y prépare. Mais la religion est faite pour un président qui règne en maître absolu depuis 22 ans sur le Cameroun, au bord de la crise des nerfs, en proie aux insomnies.
En octobre 1982, sans doute pour trouver une sortie honorable, Ahidjo, en complicité avec son épouse Germaine, feint une « maladie imaginaire » auprès de ses proches et de la France de Mitterrand. Tout le monde le croit atteint d'un traumatisme irréversible. Le 3 novembre, de retour secret d'un voyage à Paris, les choses se précipitent.
Dans le Palais d'Etoudi qui venait à peine d'être achevé, il convoque son premier ministre Paul Biya, lui fait part de sa volonté de démissionner, de lui passer les rennes du pays et lui donne une heure pour revenir avec une réponse. Les proches du président se précipitent, le supplient de revenir sur sa décision jusqu'au moment de prendre l'antenne.
Mais pour celui qui aura incarné le pouvoir avec violence et autorité comme un sacerdoce, les dés du destin sont jetés. Paul Biya lui succède le 6 novembre, Ahidjo reste président du parti. Il meurt sept ans plus tard à Dakar, l'amertume dans l'âme. La suite de l'histoire, on la connait.
Chadli Benjedid, le sacrifice ultime pour la nation
«Je demande à chacun et à tous de considérer cette décision comme un sacrifice de ma part au service des intérêts supérieurs de la nation». Les mots de la lettre de démission du troisième président de République algérienne démocratique et populaire, militaire passionné d'écriture, ont été scrupuleusement choisis. Malgré le poids de leur sens, Chadli Benjedid ne lit pas les mots, face caméra, à ses compatriotes.
A 20h30 ce samedi 11 janvier 1992, devant les caméras de télévision, le président algérien depuis 13 ans se contente de remettre sa lettre aux membres du Conseil constitutionnel, sans s'adresser au peuple. Neuf jours plutôt, il a dissout le parlement en plein entre-deux-tours des élections législatives qui font planer sur le pays le spectre d'une cohabitation entre le Front national de libération (FNL, au pouvoir) en perte de vitesse et le Front islamique du Salut (FIS), le parti islamiste, revigoré. Le pays est au bord de l'implosion.
Le 26 décembre 1991, les résultats du 1er tour affichent un raz-de-marée des islamistes qui rêvent d'instaurer un Etat théocratique. Ces derniers contrôlent déjà plusieurs localités et sont plus proches que jamais de remporter au second tour la majorité au parlement au nez et à la moustache des militaires, des politiques, de la presse et des voisins et partenaires Occidentaux de l'Algérie qui redoutent les conséquences de leur arrivée au pouvoir.
L'armée prend la direction des opérations pour stopper le processus électoral dont les risques de cohabitation ne semblent pas inquiéter le Président Chadli, promoteur invétéré de la démocratie. Dans les couloirs du pouvoir, on cherche « LA » solution pour barrer la route à un « Iran en Afrique du nord » quitte à échafauder des plans B pouvant conduire à la démission ou à la destitution sans donner l'impression d'un coup d'Etat.
Chadli Benjedid penchera pour la première solution après plusieurs hésitations. De son propre chef ou sous la pression de l'armée ? On ne saura peut-être jamais avec certitude la suite de l'histoire du Colonel Chadli Benjedid qui a emporté ses secrets dans sa tombe en 2012 à l'âge de 85 ans. Le 11 janvier 1992, l'avenir politique de l'Algérie est scellé. Avec lui, une guerre civile qui va laisser les stigmates indélébiles de la « décennie noire ».
Thabo Mbeki, pustch partisan contre l'héritier de Nelson Mandela
Dans les foyers sud-africains ce dimanche 21 septembre 2008, tout le monde est câblé sur la SABC, la chaîne nationale de télévision. A 66 ans, les cheveux plus sel que poivre, la mine sévère et les yeux rougeoyants, Thabo Mbeki annonce sa démission. L'effectivité du départ, conditionnée au vote du parlement, prend effet le 25 septembre. Dans le sillage de ce président arrivé presque à terme de son mandat, la vice-présidente et dix de ses ministres rendent leurs maroquins. Paradoxalement, presque personne n'est surpris.
Il faut dire que l' «éviction » de l'Union Buildings, le siège du gouvernement, du second président noir, successeur depuis presque dix ans de Nelson Mandela dans une Afrique du Sud postapartheid, était bien prévisible. Au sein du Congrès national africain(ANC), véritable parti-Etat se joue l'épilogue de la démission forcée de Thabo Mbeki. C'est en réalité la fin du film du duel fratricide entre le président et son ex-vice-président, entamé en 2005.
Plus tôt en 1999, lorsque Thabo Mbeki, fin intellectuel prend la succession de Nelson Mandela, il entre au Palais en compagnie de son colistier, un certain Jacob Zuma censé représenter les classes défavorisées. Mais six ans plus tard, Thabo Mbeki met sur la touche ce vice-président de plus en plus cité dans plus de 700 cas de réception de pots-de-vin notamment avec la société d'armement française Thalès. Jacob Zuma rumine une rancune de chameau.
Sa revanche, il l'a prend en 2007. Acquitté par le juge de Pietermaritzburg (sud-est) pour vice de forme dans un verdict tonitruant qui accuse le président d'ingérence dans le processus judiciaire, Jacob Zuma prend la tête du parti au pouvoir lors du Congrès de l'ANC face à Thabo Mbeki., « coup d'Etat interne », fulmine-t-on. L'ANC est au bord de se scinder en deux. A quelques mois des élections générales, pour certains notamment le puissant syndicat de la Cosatu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Thako Mbeki doit partir.
Marc Ravalomana, un « coup d'Etat » mené par un maire
Il a été chassé du pouvoir comme il y est arrivé. Dans la contestation. Elu sous les protestations lors de la présidentielle de 2001, Marc Ravalomana ne doutait pas qu'en vidant son bureau palais présidentiel d'Ambohitsorohitra, le maire de la capitale et son rival le plus farouche prendrait place sur son fauteuil.
Ce 19 mars 2009, lorsque l'homme d'affaires devenu président de Madagascar signe un décret transférant ses pouvoirs et ceux de son premier ministre à un « directoire militaire » présidé par le plus gardé, il descend les escaliers pour un exil en Afrique du Sud. Son rival Andry Rajoelina prend l'ascenseur pour accéder au sommet du pouvoir.
Assiégé jusque devant les portes du palais par des manifestants menés par son rival, le président résiste depuis plus de deux ans à la pression de la rue, haranguée par Andry Rajoelina au meilleure de sa forme politique. Ce dernier a profité de son élection à la mairie de la capitale en 2007 pour sculpter sa stature d'homme politique. Le duel entre les deux hommes, alimenté par les difficultés de trésorerie de la mairie, déclenche un bras de fer politique.
A la tête d'un vaste mouvement de protestation populaire, le maire d'Antananarivo veut prendre la place du président. Durant des mois de protestations, des manifestants parfois tombés sous les balles de la police, Andry Rajoelina réussit à rallier l'armée à sa cause. Fort de ces soutiens, il se proclame président de la Haute Autorité de la transition. Lorsque le président présente sa démission -son décret, c'est selon-, le maire prend la place du président. Pour la présidentielle de 2018, Marc Ravolamana entend s'aligner à nouveau sur la ligne de départ. Nul doute qu'il a tiré toutes les leçons du passé.
latribune