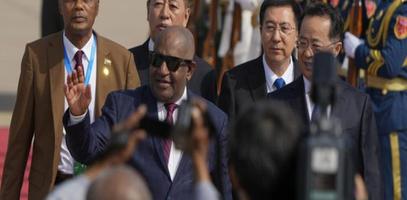N’importe quel bavard a son idée arrêtée sur la « radicalisation » et sur le terrorisme. Désormais, il est possible de confronter toute cette glose à la réalité des dossiers instruits par la justice française. Et on découvre alors la place réelle qu’occupent l’échec scolaire, les réseaux sociaux, la volonté de provoquer, la sexualité, la religion dans le basculement de milliers de jeunes vers la violence.
Les attentats qui frappent la France et l’Europe et le départ de plusieurs milliers de jeunes vers la zone irako-syrienne ont propulsé la « radicalisation » au centre du débat public. Ils ont aussi déclenché une effervescence institutionnelle d’une ampleur inusuelle. Des lois, des circulaires, des plans d’action, des financements spécifiques et des modules de formation mobilisant la police, la justice, les services sociaux, l’école, les prisons, la diplomatie, des acteurs communautaires et religieux ou encore les collectivités locales ont vu le jour en un court laps de temps. Des milliers d’agents consacrent désormais tout ou partie de leur activité à détecter, signaler, comptabiliser, surveiller, poursuivre ou prendre en charge des individus dont les comportements, les attitudes ou les actes ont été classés dans ce registre. Au point qu’un officier du renseignement souligne non sans malice : « Il y aura bientôt plus de gens qui vivent de la radicalisation que de radicaux. »
Cette mobilisation tout comme l’intérêt politique et médiatique pour le sujet ont donné lieu à une inflation d’ouvrages et d’articles dont il serait bien difficile d’établir le compte. Pourtant, rares sont ceux qui reposent sur de véritables enquêtes. Grâce à une convention passée avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), nous avons eu accès aux dossiers de 133 mineurs — 96 garçons et 37 filles — impliqués dans des affaires de terrorisme ou signalés pour radicalisation. Il s’agit d’abord de 68 jeunes qui ont été jugés ou qui vont l’être pour des départs en Syrie ou en Irak et des tentatives d’attentat sur le territoire français. À ceux-là s’ajoutent 65 mineurs condamnés pour apologie du terrorisme, ou suivis dans le cadre d’affaires pénales ou civiles ordinaires mais qui ont adopté des attitudes ou tenu des propos jugés inquiétants par les travailleurs socio-judiciaires. Les premiers représentent la quasi-totalité de ceux qui ont été poursuivis pour terrorisme entre 2012 et 2017. Les seconds ne constituent qu’un échantillon des neuf cents dossiers de ce type traités par la PJJ en juillet 2016, au moment de cette convention.
Ce contexte préoccupant invite à observer en premier lieu les dossiers de ceux qui ont tenté de rejoindre le conflit irako-syrien ou élaboré des projets d’attentat. Contrairement aux représentations communes, il ne s’agit pas de petits délinquants, déscolarisés et élevés dans des familles précarisées. Leurs parents, majoritairement des immigrés de première génération (venant principalement du Maghreb), ont tous en commun d’appartenir aux fractions stables des milieux populaires (ils sont plus volontiers ouvriers qualifiés ou artisans qu’ouvriers spécialisés) et d’avoir poussé leurs enfants à réussir scolairement afin de connaître une ascension sociale par procuration.
Cela se manifeste par une pression morale et par une bonne volonté culturelle flagrante envers l’école, mais aussi par des mécanismes extrêmement concrets pour faciliter cette réussite : chambre individuelle, bibliothèque, décharge des tâches domestiques. Cela passe également par un contrôle étroit des fréquentations, visant à mettre à distance le quartier et ses dangers en matière de délinquance ou de drogue. Enfin, cet investissement passe par le gommage des origines, qu’elles soient culturelles, religieuses ou liées à l’histoire familiale. Comme le résume le père de Foued (1) : « La famille, c’est tout mon projet. Mon capital, c’est mes enfants. J’ai fait ce qu’avait fait mon père. Il disait : “Grâce à l’école, vous allez devenir des hommes. Le point financier, c’est mon problème ; le vôtre, c’est l’école.” C’est pour ça que je crois qu’il faut sécuriser le milieu. Je suis délégué de parents d’élèves, comme ça je sais ce qui se passe à l’école. Je suis aussi représentant des locataires, comme ça je sais ce qui se passe dans le quartier, et aussi membre de l’association qui gère le culte. »
Cette protection — certains rapports parlent de « cloche parentale » — fonctionne assez bien dans un premier temps : la plupart de ces jeunes sont de bons élèves du primaire au collège. Mais l’entrée au lycée change la donne. Une grosse moitié d’entre eux accèdent aux filières générales, dans lesquelles ils découvrent un univers social assez différent de celui du collège. Dans les quartiers populaires, les normes, les sociabilités et les manières d’être circulent en effet largement entre l’intérieur et l’extérieur des établissements, produisant un entre-soi protecteur. En revanche, le lycée, généralement en centre-ville, mélange les groupes sociaux, et les élèves des milieux populaires n’y sont plus à leur avantage. Ils perdent la protection du groupe et sont confrontés à une intensification de la compétition scolaire pour laquelle ils sont moins bien armés que leurs camarades (2).
Cela se traduit par une baisse de leurs résultats (ils deviennent moyens, voire médiocres) et par de multiples petites brimades et humiliations, tant de la part des enseignants (sous la forme de commentaires oraux, d’appréciations écrites) que de celle des autres élèves, qui font volontiers bloc contre ces nouveaux venus. Ainsi, les camarades de Hamza, seul Arabe de sa classe, l’appellent en riant « le kamikaze » ou « le terroriste ». Les dossiers foisonnent de ces multiples railleries, qui sont en réalité des jugements sociaux, doublés parfois de jugements raciaux. Le registre de la rigolade permet des formes de disqualification difficiles à verbaliser autrement, sous peine d’afficher un racisme social, ou un racisme tout court. Ces vexations quotidiennes fabriquent une exclusion du groupe scolaire dominant, qu’Amin résume par la formule : « Je ne trouvais pas ma place. » Proches des jeunes des milieux populaires inscrits dans les filières d’élite étudiés par le sociologue Paul Pasquali, ceux observés ici semblent avoir manqué de ces petites choses, apparemment anodines, qui leur permettent de « passer les frontières sociales » : l’appui et les encouragements d’un professeur, des notes un peu plus élevées qui les distinguent du reste de la classe, la possibilité encore de faire corps et de se regrouper avec des lycéens issus des mêmes milieux qu’eux (3).
Pas de marionnettistes omnipotents
En raison des sanctions de l’univers scolaire, ils ne peuvent endosser la mission d’ascension sociale qui leur a été confiée par leurs parents, sans pour autant pouvoir la renier (en s’intégrant dans le monde des bandes, de la délinquance et de la consommation de stupéfiants, par exemple), à cause des dispositions qui ont été forgées tout au long de leur enfance pour mener à bien ce projet (ascétisme, appétence pour l’étude). Incapables de remplir le rôle que l’on attendait d’eux et portés par cette expérience à remettre en question l’école et la famille simultanément, ils vont trouver dans le djihadisme un vecteur pour porter la critique. Cette idéologie est indissolublement religieuse et politique. Elle propose une relecture des textes sacrés aux autres acteurs du champ religieux musulman, mais entend également agir temporellement sur les sociétés dans lesquelles elle se déploie.
La construction d’un État « islamique » comme les attentats perpétrés dans un certain nombre de pays ne relèvent pas seulement d’une quête spirituelle visant à préparer le règne de Dieu : cela traduit aussi un projet politique qui prend symboliquement et physiquement pour cible les gouvernements, les institutions et certains groupes (les « mécréants », les « juifs », les « homosexuels », les « mauvais musulmans »). Dans les dossiers étudiés, cette idéologie apparaît comme une solution commode pour condamner dans un même mouvement le modèle parental, qui serait contaminé par les valeurs de la société d’accueil dans son investissement scolaire, dans son matérialisme, dans son refus des origines (qu’elles soient culturelles ou religieuses), et le modèle républicain incarné par l’école. L’échec n’en est désormais plus un. Il se transmue en choix délibéré de la fidélité à une communauté idéelle, qui incarnerait une pureté originelle, tant du point de vue de ses valeurs que de ses pratiques.
Ce processus est graduel et collectif. Coupés des sociabilités de rue par le contrôle familial, exclus de celles qui se développent ordinairement au lycée, ces jeunes recherchent d’abord des « gens comme eux » avec lesquels nouer des relations. Cette quête emprunte des voies diverses — et pas nécessairement exclusives —, de la création d’un petit groupe à l’école ou dans le quartier à la recherche sur les réseaux sociaux, en passant par l’exploration des relations familiales (cousins, cousines, oncles, tantes, etc.) ou la fréquentation de lieux de culte et d’associations culturelles ou sportives. Yamin et Aïssa sympathisent ainsi en classe d’espagnol et s’échangent des vidéos sur la Syrie récoltées sur YouTube (« avec des civils qui se faisaient torturer »), avant de décider, quelques mois plus tard, d’y partir ensemble. Mehmet se tourne vers deux amis qu’il conserve depuis l’enfance. Lorsque ses parents le laissent sortir, ils parlent de religion, puis de la Syrie. Quant à Nisrine, elle évoque un « repli social » et un renouveau de ses relations sur Internet, choisies en fonction de leur intérêt pour la religion.
La mise en commun des expériences et la convergence des affinités limitent le découragement, favorisent le regroupement et facilitent la prise de conscience. « J’ai discuté avec des gens ayant les mêmes difficultés que moi », résume ainsi Fabienne, une jeune femme poursuivie pour tentative d’attentat et de départ en Syrie.
Néanmoins, le fait que deux jeunes qui fréquentent la même école ou se sont rencontrés grâce à Facebook s’aperçoivent qu’ils partagent un sentiment de déclassement ne suffit pas, et de loin, à leur fournir une grille de lecture cohérente de leur propre situation. Il faut pour cela qu’ils entrent en relation avec des tiers plus aguerris idéologiquement, qui jouent un rôle-clé pour politiser leurs désajustements scolaires et familiaux en les reliant à d’autres événements (de l’histoire aux relations internationales) et en instaurant des chaînes de causalité qui les expliquent.
Les noms de certains, que l’on croise dans la plupart des dossiers, sont connus, comme M. Omar Omsen ou Rachid Kassim, souvent présentés comme les principaux recruteurs francophones. Ils offrent une intelligibilité aux expériences (scolaire, familiale, sociale, en matière de racisme, d’islamophobie) des jeunes auxquels ils s’adressent, à partir d’explications puisées dans les divers courants de la nébuleuse djihadiste. « On pouvait lui poser n’importe quelle question, résume Foued au sujet de M. Omsen, il avait réponse à tout. » Ils vont également leur fournir l’accès à des discours, des textes, des films et des brochures permettant d’étayer leurs dires, voire des conseils pratiques, depuis des techniques de sécurité jusqu’à des itinéraires, des contacts et même des financements.
Progressivement, la densification des relations physiques et numériques donne une cohérence aux petites communautés en train de se former. Les plus modérés, les moins convaincus, les tièdes s’en détachent progressivement. Au contraire, les autres fortifient leurs convictions et en viennent à partager une vision du monde de plus en plus proche. « J’ai arrêté de parler avec des gens qui ne pensaient pas comme moi », explique ainsi Nisrine, devenue par la suite administratrice de la chaîne Dine Al-Haqq sur l’application Telegram. Par paliers successifs, le groupe se restreint et réunit des individus de plus en plus semblables dans leurs comportements et leurs modes de pensée. La coupure qui s’instaure par ailleurs renforce les liens affectifs en son sein. Les pairs deviennent « des autres moi », comme le raconte Morgane, envers lesquels on ressent une loyauté et parfois de l’amitié.
La force de ces petits groupes affinitaires est décisive pour comprendre les passages à l’acte. Le substrat intellectuel fourni par des individus comme Kassim ou M. Omsen ou les savoir-faire qu’ils mettent à disposition ne suffiraient pas à expliquer l’engagement. Ils ne sont pas les marionnettistes omnipotents que se plaisent à décrire certains analystes. La distance physique et le caractère intermittent des relations qu’ils entretiennent avec les jeunes étudiés ne leur permettent pas de les contraindre à agir ni de contrôler l’usage que ces derniers font de l’idéologie qu’ils professent. Ils offrent des raisons d’agir et des modes d’action, mais la manière dont les jeunes s’approprient leurs enseignements leur échappe.
Ainsi, la hijra — l’exil en terre d’islam — en Syrie exerce un attrait considérable sur la plupart d’entre eux. La construction concrète, sur un territoire déterminé, d’une organisation sociale et politique conforme à des préceptes et des normes définis par leurs promoteurs comme « véritablement islamiques » donne à la situation le statut d’une utopie, à l’avènement de laquelle ils veulent participer (4). « C’est là que ça se joue ! », explique par exemple Nazim avec effusion.
L’horizon syrien apparaît ainsi riche de promesses inaccessibles en France pour ces mineurs. L’expérience est parée de toutes les vertus, dotée de la capacité de régler dans un même mouvement tous leurs problèmes : l’autonomie vis-à-vis des parents (avec lesquels on veut mettre de la distance), les questions matérielles de logement et de salaire (toujours délicates en milieu populaire), le sens de la vie (le dévouement à la communauté et à la cause lui donnant une autre portée), les relations entre groupes sociaux (devenant miraculeusement confraternelles dans la religion) et même la sexualité (désormais dépouillée des relations de compétition). De la même manière, et compte tenu de leurs dispositions scolaires, ces jeunes se montrent assez enthousiastes à l’idée de devenir à leur tour des petits intellectuels militants, à l’image de Saïd, qui se définit comme un « moudjahid du clavier » et souhaite contribuer à diffuser la cause à laquelle il croit.
En revanche, ils semblent moins partants pour commettre des attentats. Nombreux sont ceux qui se réjouissent des attaques qui ont été perpétrées sur le territoire français et qui parlent d’en mener eux-mêmes. Mais l’examen de leurs dossiers judiciaires permet de constater — à quelques exceptions près — que leurs projets présentent un haut niveau d’impréparation, voire d’irréalisme. À la différence de certains de leurs homologues, précocement engagés dans la délinquance, leur socialisation ne les a guère préparés à manier des armes, ni même à savoir où s’en procurer. Ainsi, lorsque Linn explique qu’elle comptait acheter des kalachnikovs et des ceintures d’explosif afin de « prendre pour cible des lieux le plus fréquentés possible », elle semble bien incapable de savoir où les chercher.
Cela ne veut pas dire qu’ils soient incapables de passer à l’action. La commission d’un attentat comme le départ effectif en Syrie doivent ainsi beaucoup aux effets d’entraînement observables à l’intérieur des petits groupes affinitaires, dans lesquels il faut en permanence tenir sa place et démontrer sa loyauté. Ils apparaissent également comme la conséquence non voulue de réponses institutionnelles qui provoquent des dynamiques d’escalade. Ainsi, l’opposition croissante du personnel enseignant et administratif de son collège face à l’attitude jugée prosélyte et revendicatrice de Matthis, de même que la perquisition de son domicile et l’assignation à résidence qui l’a suivie ont contribué à ce que l’adolescent mette sur pied un projet d’attaque qui aurait pu s’avérer meurtrière. De la même manière, Yamin part en Syrie après qu’un policier lui a annoncé qu’il risquait dix ans de prison dans une petite affaire de bagarre scolaire.
Un second résultat saillant de cette enquête surprendra sans doute les lecteurs habitués à la glose des experts les plus alarmistes. À l’exception des cas étudiés ci-dessus, l’essentiel des comportements classés sous l’étiquette « radicalisation » par les professionnels de la justice n’entretiennent guère de lien autre que discursif avec le djihadisme. L’écrasante majorité des mineurs signalés ne sont pas porteurs d’un projet idéologique et ne prétendent pas faire advenir un ordre social, politique et symbolique alternatif à celui dans lequel ils vivent. Dans une actualité marquée par des attentats meurtriers et par l’inquiétude publique qu’ils suscitent, ils adoptent des postures et des discours empruntés au répertoire djihadiste dans les interactions avec leurs familles, leurs pairs et les organisations d’encadrement de la jeunesse — de la police à l’école, en passant par les services sociaux et judiciaires. Cet usage leur permet notamment de déstabiliser les adultes auxquels ils sont confrontés.
Le cas de Bryan, mineur condamné à une mesure de liberté surveillée préjudicielle (LSP) pour des faits de délinquance, illustre bien cette dynamique. Dans ce cadre, il participe au sein de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) à un atelier de création vidéo sur le thème du respect entre les garçons et les filles. En entrant dans le théâtre où se déroule l’atelier, il lance : « C’est comme le Bataclan, ici. » Puis, dans la réunion préparatoire avec l’équipe de tournage, il adopte un discours « inadapté et irrespectueux » à l’encontre des femmes présentes, avant de lâcher : « Il faut brûler le théâtre. » Comme nous le raconte Arnaud, le responsable de l’UEAJ, « finalement, il vient quand même. Il ne met pas le feu au théâtre, mais il s’en prend à une des réalisatrices, qui participe à l’équipe de professionnels pour faire des courts-métrages. Il lui a dit clairement : “Toi, je vais t’égorger !” Et après, il dit : “Non, mais je rigole, ce n’est pas vrai”, mais elle n’est pas du tout en sécurité avec ce jeune-là. Il finit quand même le projet avec nous. Il est un peu bizarre dans son comportement, il est un peu fuyant, mais en même temps provocateur. Il se cherche. Il nous dit aussi qu’il est “fiché S”, qu’il est un terroriste, qu’il est un fou… ».
Ce registre permet d’abord à Bryan de prendre le contre-pied des attentes explicites de l’institution en termes de comportement et de discours, par exemple en dévaluant et en menaçant des femmes dans un atelier portant sur l’égalité entre les sexes. Ensuite, il « grandit » le mineur en laissant planer le doute sur sa dangerosité potentielle (« je vais t’égorger », « je suis “fiché S” », « je suis un terroriste »), même si celle-ci ne repose sur aucun élément concret et qu’elle est exprimée de manière trop ostentatoire pour sembler complètement crédible. Mais le résultat reste à son avantage : il a complètement désorganisé l’atelier et accaparé l’attention.
Les propos choquants qu’ont pu tenir des élèves après les attentats de janvier puis de novembre 2015 relèvent de la même logique. Dans un contexte marqué par des injonctions politiques et institutionnelles à se solidariser avec les victimes, tenir des propos outranciers constitue une option facile pour récuser une institution qui les rejette. Comme le résume Cynthia, une éducatrice, « pour un gamin, arborer l’identité de Daech, cela peut faire aussi partie d’une construction identitaire, cela peut faire partie d’une forme de provocation. Parce que aujourd’hui c’est le truc le plus sensible. Un jeune vient en entretien : “Vous ne me connaissez même pas. Moi, je suis pire que Daech !” Forcément, c’est la chose qui fait peur ».
Le caractère stratégique de ces attitudes, dont le fondement est d’ébranler l’autorité des adultes à l’école, dans le travail éducatif ou dans la famille, ne doit pas être sous-estimé. Celles-ci représentent l’écrasante majorité des situations signalées auprès de la PJJ, mais probablement aussi du numéro vert Stop djihadisme, des cellules de suivi pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles (CPRAF) des préfectures ou des instances propres aux services sociaux et à l’éducation nationale. Non seulement elles ne sont pas un marchepied vers l’action violente, mais elles trouvent au contraire leur raison d’être dans une volonté de susciter une réaction chez ceux vers lesquels elles sont dirigées. En d’autres termes, l’essentiel des comportements enregistrés aujourd’hui en France sous le label « radicalisation » ne constituent pas des « signaux faibles » de djihadisme, mais plutôt les manifestations éclatantes d’une défiance envers des familles ou des institutions.
Qu’il s’agisse d’un cri de révolte ou d’un engagement idéologique consécutif à une impossibilité d’endosser un rôle attendu, on perçoit les bénéfices de revenir — un peu à la manière d’Émile Durkheim dans son étude des déterminants du suicide (5) — sur les logiques sociales qui forment le socle de certains comportements. Cela permet d’abord de dissiper l’illusion qu’il existerait une radicalité, fût-elle djihadiste, marquée seulement par des différences de degré et que traduisent parfois jusqu’à la caricature les « échelles de radicalisation » et leur code couleur, du vert au rouge. Accepter que la provocation et l’engagement ne relèvent pas des mêmes dynamiques, c’est se donner les moyens de calibrer les réponses publiques et d’éviter de surréagir à des propos ou à des attitudes certes choquants, alors que c’est précisément ce qui est recherché.
Étudier les logiques à l’œuvre permet ensuite de faire un pas de côté par rapport à la quête illusoire de profils de « radicaux ». Ce n’est pas parce que des gens ont des propriétés sociales ou des expériences similaires qu’ils feront la même chose. Le désajustement entre les aspirations des jeunes étudiés et les verdicts de l’école est apparu central dans l’enquête. Mais ce mécanisme reste banal : psychiatres et psychologues y voient la cause de nombreux cas d’anxiété, d’abattement, de déprime, d’automutilations, de tentatives de suicide ou d’anorexie qu’ils ont à traiter. L’engagement djihadiste peut constituer un autre type de réaction, mais qui demeure très exceptionnel. Il ne concerne que soixante-huit mineurs, soit un élève du second degré sur cent mille en 2017.
En outre, les attentats récents comme les procès pour les retours de Syrie ou d’Irak montrent que des jeunes ayant connu des trajectoires familiales plus chaotiques et au casier judiciaire fourni peuvent également être impliqués (6). Ils sont néanmoins un peu plus âgés que leurs homologues étudiés ici. Ce décalage s’explique sans doute par le fait que ces derniers perçoivent l’engagement djihadiste — et l’expérience syrienne en particulier — comme la seule solution à court terme à l’effondrement d’un projet de vie totalisant dans lequel ils étaient investis corps et âme. En revanche, ceux qui appartiennent au monde des bandes et de la délinquance semblent avoir besoin d’un peu plus de temps pour épuiser les options qu’ils ont à leur disposition. L’exemple d’Amedy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015, est significatif. Comme le souligne Fabien Truong, c’est sans doute la combinaison d’une usure de la rue — où, pour maintenir sa place et son prestige, il doit enchaîner les braquages — et de la confrontation répétée aux forces de l’ordre et à la justice qui explique comment sa trajectoire a pu s’infléchir vers la radicalité violente (7). De la même manière, la volonté d’effacer le passé — par une renaissance que vient consacrer jusqu’au changement de nom —, de se mettre à l’abri de poursuites policières et pénales, l’émulation entre copains, la soif de trouver un sens plus profond à l’existence sont autant de raisons du départ vers la Syrie ou l’Irak de nombre de jeunes qui ont connu des carrières délinquantes.
À rebours des fantasmes d’un profilage qui permettrait de prédire des passages à l’acte, les sciences sociales permettent au moins de les comprendre. Et cette compréhension ne constitue pas une « excuse sociologique » ou une insulte à l’égard des victimes, comme le disent un peu rapidement certains responsables politiques. Ainsi que l’apprend douloureusement le frère survivant de l’histoire des trois pêcheurs prisonniers d’une tempête contée par Edgar Allan Poe, pour espérer sortir indemne du maelström, il faut d’abord accepter d’en étudier calmement les manifestations et les logiques de fonctionnement (8). C’est à ce prix que l’on peut éclairer l’action institutionnelle et s’assurer qu’elle ne va pas aggraver les phénomènes qu’elle entend combattre, par exemple en fabriquant inutilement des catégories de suspects.
Laurent Bonelli & Fabien Carrié